
Manoël Pénicaud
Le pèlerinage en images. Expérience d’un tournage chez les Regraga dans le sud-marocain : Les Chemins de la Baraka (2004 – 2007)
Récit de la réalisation d'un premier film sur le pèlerinage des confréries Regraga au Maroc qui révèle les coulisses du tournage de quatre ans effectué par l’auteur (anthropologue) et Khamis Mesbah (cinéaste).
« Le seul conseil que l’on peut donner à des jeunes gens qui veulent faire du cinéma, c’est de faire de l’école buissonnière une règle de vie, mais en la faisant très sérieusement. »((Citation extraite de l’entrevue filmée « Jean Rouch raconte Pierre-André Boutang » (104mn), sur le 4e DVD du coffret Jean Rouch (Collection Le Geste cinématographique, Éditions Montparnasse, 2004).))
Jean Rouch
J’étudiais le pèlerinage des Regraga depuis deux ans déjà. Une vaste pérégrination maraboutique de quarante jours qui a lieu au printemps dans la région d’Essaouira (Maroc). La photographie occupait une place importante dans mon approche ethnographique. Ces images étaient si fortes que l’idée de passer au film est née fin 2003, mais je doutais vraiment que ce soit réalisable. Mon long travail d’approche et d’immersion dans une confrérie Regraga risquait – pensais-je – d’être balayé par la seule présence d’une équipe, aussi légère fut-elle. Mais l’idée fit son chemin. Je rencontrai en France un jeune réalisateur – Khamis Mesbah – intéressé par ce sujet atypique qui le rattachait à ses origines marocaines. Nous avons alors commencé à travailler de concert : écriture, traitement, production, etc. Le premier tournage (autoproduit) eut lieu en 2004 : ce fut le plus épique que j’aie jamais connu. Au printemps 2007, nous finissons le film avec les moyens du bord, après une traversée du désert due au mirage d’une éventuelle diffusion télévisée.
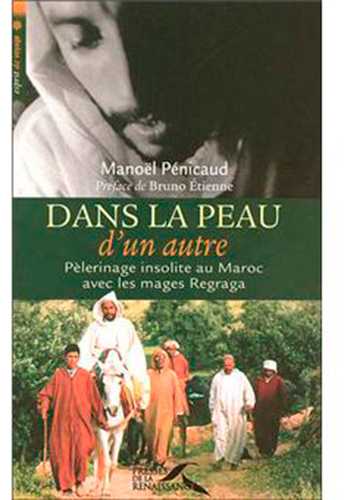
Aujourd’hui, le film existe. Est-il proprement ethnographique ? Est-ce un documentaire ? Un film d’auteur ? La question reste ouverte. En tout cas, il est né d’une ethnographie sans laquelle il n’aurait jamais vu le jour((Ce film a été réalisé en marge de ma thèse de doctorat qui ne porte plus que très indirectement sur le pèlerinage des Regraga. Ainsi, me suis-je senti libre de me consacrer à cette expérience audiovisuelle sans la pression d’un certain académisme universitaire.)). Comme dans tout premier film, les imperfections sont nombreuses, sans parler des aléas et des déboires sur le terrain. J’ai connu depuis d’autres tournages dans d’autres domaines (télévision, cinéma), mais le présent article est l’occasion de se pencher avec du recul sur ces trois années passées à tâtons sur ces chemins de la Baraka…
A travers le récit de la réalisation de ce premier film, j’espère pouvoir dégager quelques éléments de réflexion sur des thèmes plus généraux : Que filmer et comment filmer ? Ou bien que ne pas faire ? Et pour cadrer avec la thématique globale : comment articuler érudition et émotion ? Sans m’aventurer outre mesure sur le terrain des théoriciens du film anthropologique, je pense que cette expérience cinématographique est multiple, l’enrichissement inattendu, et la réflexion salutaire. Après maints allers, détours et retours, nous avons fait ce film comme nous l’entendions, sans chercher à tout expliciter et en laissant la place aux silences, aux paysages, à une certaine poésie, fidèles à nos choix de traitement filmique.
Une précision doit être apportée : nous parlons ici de la première version finalisée du film Les Chemins de la Baraka, présentée en avant-première au festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo en mai 2007. A peine revenus du dernier tournage, nous avons travaillé d’arrache-pied au montage et sommes passés d’un projet provisoire de 26’ à 50’. Cette version – bien que cohérente et assumée – pourra encore évoluer afin de s’adapter à un plus large public. Mais tenons-nous à la version actuelle, puisque c’est d’abord d’expérience dont il est question, à travers les différentes phases d’élaboration du film : les tournages, les temps creux, et le montage.
Les Regraga
Les Regraga accomplissent à chaque printemps ce pèlerinage de quarante jours appelé Daour («tour ») – pendant lequel « ils tournent sur les saints ». Ils visitent en effet pieusement les tombeaux de quarante-quatre de leurs saints ancêtres disséminés dans le pays Chiadma au nord de la vie côtière d’Essaouira. Le mythe fondateur raconte comment sept premiers saints – chrétiens berbères à l’origine – auraient rencontré le Prophète Mohammed à la Mecque de son vivant et se seraient convertis à l’islam à son contact. Ce dernier, après les avoir affublés du nom de « Rejraja », les aurait chargés de rapporter cette nouvelle religion au Maghreb((Ne comprenant pas leur dialecte berbère, Fatima, la fille du Prophète, se serait exclamée : « Qui sont ces hommes qui bredouillent ? ». A quoi le Prophète aurait répondu : « Tu viens de leur donner leur nom : Rejraja ».Tel est le mythe fondateur qu’il n’était pas question de remettre en question ni de vérifier dans ce film qui se situe dans une démarche ethnographique et non pas historique. Nous prenons le mythe au sérieux comme les Regraga eux-mêmes.)). Ainsi, seraient-ils des Compagnons du Prophète ignorés ainsi que les premiers Musulmans du Maroc.
Représentants d’un certain soufisme populaire et rural au Maroc, les Regraga forment une confédération maraboutique peu connue, organisée en treize zaouïas auxquelles appartiennent tous les descendants des quarante-quatre saints, eux-mêmes issus des sept saints fondateurs. J’estime la distance du pèlerinage entre 450 et 500 kilomètres, parcourus principalement à pied ou à dos d’âne. Notons que les Regraga sont difficilement quantifiables, puisque chacun est libre d’effectuer une partie ou la totalité du Daour. Ainsi, sont-ils parfois des centaines, voire des milliers à certaines étapes, mais cheminant par groupes réduits et distincts, selon des sentiers connus d’eux seuls, à travers la province rurale d’Essaouira.
En chemin, les Regraga, distribuent la Baraka – la grâce divine – aux habitants des contrées traversées. Leurs adeptes viennent solliciter ces « hommes purs » afin qu’ils prient en leur faveur pour des motifs aussi variés que la santé, le mariage, l’enfantement, la réussite professionnelle ou scolaire, etc. En guise de contre-don, les gens offrent aux Regraga des biens en espèces ou en nature, ainsi que le gîte et le couvert. Chaque étape donne lieu à un moussem, fête locale et patronale en l’honneur du saint concerné, où les rituels religieux (prières, offrandes, processions) jouxtent le souk marchand où viennent s’approvisionner les gens de ces contrées reculées. Le passage des Regraga est un grand jour de fête, et ils doivent être accueillis avec honneur, comme des « seigneurs » puisqu’ils sont considérés comme des chorfa. Telle est la toile de fond des Chemins de la Baraka.
Le travail en binôme
Lors d’un colloque auquel j’avais assisté au début de mes études, un éminent historien avait affirmé l’incapacité des chercheurs à réaliser eux-mêmes leurs propres films. Sans doute avait-il raison, puisque tout le monde avait approuvé : il est vrai que la plupart des chercheurs ignorent encore les techniques cinématographiques ou ne savent pas les manier convenablement. Mais chaque génération baigne un peu plus dans l’image que la précédente. Ainsi ai-je moi-même grandi avec une caméra, et mon œil s’est affûté au fur et à mesure de tournages ludiques. Je continue à penser qu’il est possible de concilier approches scientifique et audiovisuelle. Et quand bien même cela reste un long apprentissage, le travail en association offre un premier chemin d’accès.
Bien qu’ayant cultivé une sensibilité pour l’image (notamment en photographie), je n’aurais jamais pu prétendre utiliser la caméra comme je l’aurais voulu. C’est en cela que le travail en binôme opéré avec Khamis Mesbah – cadreur de son état – s’est avéré pertinent. Nous incarnions chacun deux domaines distincts : de son côté la technique audiovisuelle, et du mien la connaissance scientifique, tandis que l’esthétique demeurait au centre. Car j’avoue que le style et l’esthétique comptent, selon moi, pour beaucoup dans un film, quel qu’il soit. Nos approches étaient distinctes mais pas foncièrement incompatibles : le tout était de trouver le point d’équilibre, un point d’ancrage, des zones de compatibilité et d’entente.
Au final, notre complémentarité aura été vraiment enrichissante, même si nous avons rencontré un certain nombre de déconvenues, divergences et conflits. Nous nous sommes effectivement confrontés aux problèmes auxquels se heurte toute entreprise de cet ordre, et ce, d’autant plus dans le contexte difficile d’un pèlerinage long et éprouvant. Travailler en binôme exige une grande complicité, une connaissance réciproque du partenaire, ou bien un professionnalisme tel que l’intérêt du film passe avant tout. Tel n’était pas notre cas : nous avons tout appris sur le tas. Nous avions beau respecter les règles élémentaires de tournage, nous n’avons pas pu échapper au manque d’expérience qui était le nôtre. Et nous avons avancé par tâtonnements, tentatives et autres initiatives.
Khamis Mesbah se concentrait exclusivement sur l’image, car le cadrage exige une maîtrise sans faille. On n’a pas le droit à l’erreur, de rater son plan, car chaque scène est unique. Impossible de demander à un « personnage » de répéter ce qu’il vient de faire ou de dire. Quant à moi, je restais hors champ, gérant les imprévus, les réactions, les embûches, interrogeant les informateurs, multipliant gestes et signes silencieux, par exemple pour que des enfants curieux n’entrent pas dans le cadre, ou ne fixent pas inopinément l’œil de la caméra, cela donnant lieu à des interactions parfois cocasses dont seul un making-of saurait rendre compte. Lors du second tournage de 2007, j’étais plus expérimenté et je m’occupais du son, ce qui me permettait d’être concentré sur l’environnement sonore mais aussi sur tout ce qui se passait hors du cadre.
Le langage cinématographique
L’image est un langage polysémique, « une écriture en mouvement » dont il faut connaître l’alphabet pour mieux s’exprimer. Cet apprentissage peut prendre un certain temps, mais il est fondamental : plan court, plan-séquence, profondeur de champ, raccord, sortie de champ, etc. Plus encore, une fois le vocabulaire acquis, l’on doit maîtriser les règles d’orthographe, de conjugaison et de syntaxe. Certes, on voudrait se passer de telles contraintes et inventer son propre style, mais il en va de même qu’en littérature ou qu’en musique : il faut maîtriser ces codes pour mieux s’en affranchir. C’est un passage obligé. Et Colette Piault d’ajouter à ce sujet : « Peut-être les ethnologues ont-ils encore trop tendance à penser que l’intérêt « scientifique exceptionnel » de leur sujet leur donne le privilège de négliger quelque peu les règles les plus élémentaires de la syntaxe cinématographique (…)Il faut également reconnaître que les meilleurs films d’anthropologie n’ont pas été réalisés par des anthropologues, mais par d’excellents cinéastes, cameramen professionnels intéressés par le domaine de l’anthropologie sociale, capables de rester longtemps sur un terrain, de comprendre les problèmes et d’établir des liens privilégiés avec les personnes filmées »((Langlois C., Morel A. & C. Piault, 1986, « Cinéma et ethnologie européenne : entretien avec C. Piault », Terrain, n° 6, pp. 72-77.)).
De la technique
Outre ce langage, la maîtrise de la technique demeure l’un des principaux handicaps pour l’ethnologue. Si les outils du chercheur sont plutôt intellectuels, l’audiovisuel implique une évidente dimension technique et manuelle. Quel matériel choisir ? Comment le manier ? Quelles en sont les limites ? Autant de points noirs qui effraient le novice en la matière. Qui plus est, les techniques numériques évoluant sans cesse, il faut être en perpétuel apprentissage pour être « à la page », ce qui sous-tend une disponibilité et un intérêt préalables. Or, c’était bien le domaine de compétence de Khamis Mesbah, alors que j’étais encore incapable de faire une balance des blancs, de cadrer un plan panoramique avec fluidité ou bien de régler la profondeur de champ.
Parallèlement, ces matériels technologiques s’allègent à la même vitesse qu’ils évoluent, et les conditions de tournages s’en retrouvent considérablement assouplies. Pour nous justement, l’impératif était de rester légers, pour des raisons financières d’une part, et contingentes d’autre part. Nulle possibilité d’emporter des équipements trop encombrants (steady-cam par exemple), mais qui auraient pu être utilisés dans d’autres conditions. L’avantage d’un plan que l’on prépare soigneusement, est qu’il figurera à coup sûr dans le montage définitif et qu’il rehaussera la dimension esthétique du film.
Le tournage 2004
Avant tout, je dois confier mes appréhensions d’ethnologue en amont du tournage, de voir « mon » terrain envahi par des tiers, de peur qu’ils ne mettent les pieds dans le plat ou dans mes plates-bandes ! La confiance avec les Regraga était grande et partagée, mais un faux-pas pouvait tout compromettre. Notre équipe devait donc être la plus légère possible (trois personnes en 2004 et deux en 2007), la moins regardante aussi sur les horaires et les conditions de tournage. Je redoutais les perturbations occasionnées par la caméra sur le réel (profilmie), ainsi que le comportement de mes deux compagnons((Khamis Mesbah (co-réalisateur) et Rachid Amrirat (ingénieur du son).)). Cette approche se différenciait en fait radicalement de mes précédents terrains basés sur la discrétion et l’observation participante. Avec une caméra, on ne passe jamais inaperçu, et l’on devient vite « l’observateur observé ». Finalement, la profilmie n’est pas un problème : c’est juste une condition de base à assumer et avec laquelle savoir composer.
Après qu’un premier producteur nous a fait miroiter en vain le soutien financier d’une chaîne câblée, nous partîmes en mars 2004 au Maroc avec des moyens associatifs. Sur place, nous allions accompagner dans sa pérégrination l’un des treize groupes de Regraga : la Zaouïa d’Akarmoud. J’avais noué des liens suffisamment forts avec Si-Ahmed, chef charismatique et héréditaire de cette fraction, pour qu’il accepte sans détour notre présence. Il ne pouvait pas prendre la route à cause d’une maladie (toukal, donc plutôt un « empoisonnement »), et ce devoir incombait par conséquent à son fils aîné Abdelhaq.
Le travail d’équipe
Au final, ce premier tournage accompli en 2004 fut un véritable parcours du combattant. Il s’étala sur dix-huit jours, soit exactement la moitié du pèlerinage((Pour ma part, je suis resté sur le terrain pendant la totalité, mais l’équipe et le matériel ne pouvaient pas y demeurer plus longtemps.)). Nous étions toujours en mouvement, dans le sillage de la confrérie que nous accompagnions nuit et jour, sans avoir vraiment le temps d’ajuster au mieux notre matériel. Certes, nous avions pris soin d’acheter un âne pour porter notre équipement, mais ce n’était pas suffisamment commode pour « dégainer » en pleine action notre caméra et nos micros. Car nos pèlerins et compagnons ne s’arrêtaient jamais : rien ne pouvait les écarter de leur route, ni de leur emploi du temps qui est millimétré à l’heure près. Inconcevable dès lors de leur demander de ralentir ou bien de mettre en scène quoique ce soit. C’était déjà un privilège de les suivre, à nous de nous adapter.
Sur le terrain, Khamis Mesbah et Rachid Amirat (preneur de son) furent assez vite acceptés, en tout cas plus vite que je ne l’aurais cru : leur marocanité leur ouvrit des portes que j’avais mis beaucoup plus de temps à franchir. Ils comprenaient l’arabe dialectal et, en tant que musulmans, pouvaient entrer dans les mosquées et les koubba (tombeaux des saints), ce qui ne m’était pas permis – a priori – puisque j’étais considéré comme nasrani, comme « chrétien ». Sans ce choix de coéquipiers d’origine marocaine, le tournage aurait été plus que compromis.
Cette année-là, la chaîne nationale marocaine 2M produisit un reportage télévisé sur la pérégrination des Regraga. Or, même si la télévision est censée ouvrir toutes les portes, l’équipe de tournage se vit mettre plus d’un bâton dans les roues. Cette équipe d’une dizaine de personnes travailla trois jours, en survol, se déplaçant en 4×4, alors que nous vivions avec les pèlerins dans la durée, nous déplaçant à pied avec notre âne. Suivant le mot de Luc de Heusch, nous pratiquions bel et bien – et sans le savoir – la « caméra participante » typiquement anthropologique, partageant avec les pèlerins les moments les plus intimes de la vie communautaire de cette société pèlerine (la « communitas » chère à Victor Turner) qui vit selon des us et coutumes propres à ce temps défini – et « extra-ordinaire » – du pèlerinage, alors que l’équipe de télévision évoluait selon le rythme du temps classique (celui de la « structure » de Victor Turner).
Le « scénario rituel »
Nous bénéficions de mes deux années d’approche proprement ethnographique qui m’avaient permis d’être bien intégré dans le groupe que nous suivions. L’atout de l’ethno-réalisateur est qu’il maîtrise son sujet sur le bout des doigts : en l’occurrence, je connaissais par cœur le « scénario rituel » du pèlerinage : la chronologie, les distances, les haltes, les difficultés du parcours, les séquences fortes, etc. sans quoi, rien n’aurait été possible((C’est aussi l’avantage de filmer un rituel qui se répète (quasiment) à l’identique d’année en année.)). Jusque-là, rien n’avait été cartographié ni kilométré. Les Regraga ont quelque chose d’insaisissable et disparaissent très vite… Concrètement, nous pouvions anticiper, prendre de l’avance sur tel sentier parce que savais par exemple que le point de vue (esthétique) serait intéressant au détour de tel virage ou bien qu’un groupe de femmes attendrait un peu plus loin le passage du jeune Abdelhaq monté sur sa jument blanche. C’est là un point fondamental.
Limites
Pourtant, cette connaissance à la fois pratique et érudite dont jouit l’ethnologue peut aussi se muer en obstacle et l’exigence en contrainte. Là encore, le travail en binôme peut éviter certains écueils. Le regard neuf et moins connaisseur d’un spécialiste de l’audiovisuel peut accoucher d’images très fortes, sur le fond comme sur la forme. Il pourra, avec le recul qui est le sien, apporter quelque chose de plus à l’ethnologue. Nous touchons là en fait au coeur du problème : en matière de cinéma, il faut savoir travailler en équipe. Il s’agit exactement de la même dialectique que pendant la phase cruciale du montage (cf. infra), quand la participation d’un monteur professionnel est vivement recommandée parce qu’il connaît parfaitement le langage cinématographique et contrebalance l’exigence de l’ethnologue en adoptant le point de vue du spectateur non-spécialiste.
Outre quelques expériences antérieures, c’était mon premier tournage digne de ce nom. Or, j’étais « incorrigible », dans la mesure où je voulais filmer le plus possible et ne rien manquer, quitte à filmer plusieurs fois le même type de séquence. En fait, mieux vaut s’appliquer à filmer convenablement une seule procession, plutôt que quelques extraits chaque jour. Ne mesurant pas les contraintes proprement techniques du cadre comme du son, j’étais souvent directif, ce qui n’est jamais bon dans une équipe. Cette « boulimie d’images », ce désir de voir la caméra avaler le plus de « réalité » possible est symptomatique d’un ethnologue inexpérimenté qui voudrait tout capturer, car pour lui, chaque rush aura du sens. Evidemment, tout a toujours un sens, mais dans certaines conditions, il faut savoir choisir dès la prise de vue. J’avais ce même réflexe avec la caméra qu’avec mon carnet dans lequel j’avais appris à tout consigner, n’importe quand, n’importe où. Or, l’écriture cinématographique se pratique autrement, a fortiori parce que l’on n’est plus seul, et j’ai dû apprendre à respecter un autre rythme de travail et de captation d’informations. En fait, tout était histoire d’équilibre et de réciprocité : j’avais besoin de Khamis Mesbah comme lui avait besoin de moi. « Rien ne sert d’avoir des images claires si les idées sont floues », dit Jean-Luc Godard… et vice versa ai-je envie d’ajouter !
L’apprentissage commun
Chacun apprend sur le tas les « trucs » qui font un bon tournage, les clés à utiliser au bon moment, le type de comportement à adopter, ou bien les écueils et les erreurs à ne pas faire. C’est l’école du terrain. Fidèle à la phrase de Jean Rouch, j’ai fait de « l’école buissonnière » une méthode. Prenons l’exemple des techniques d’entretien : chacun s’y prend comme il veut. Pour ma part, j’ai vite su poser des questions ouvertes et laisser l’informateur s’exprimer sans limite, sans qu’il ne se préoccupe de la caméra. L’idéal étant de mettre en confiance sans mettre en scène. Absorbant son regard dans le mien, je m’appliquais à ne faire aucun bruit, à acquiescer par geste ou seulement des yeux pour ne pas le couper dans son élan, ni « altérer » la bande-son. En effet, certaines interjections répétitives extérieures au cadre peuvent nuire à l’entretien, de la même manière qu’un pic de son, (un coup sur le micro par exemple), peut saper une phrase et la rendre inexploitable par la suite.
Nous nous situons hors du débat qui oppose les adeptes du trépied pour la caméra et les tenants du « tout-à-l’épaule ». Il n’y a pas de règle ! Chacun procède selon son « feeling », et selon les conditions de tournage. Parce que si le pied a beau donner une image de bonne qualité (« propre » dit-on), encore faut-il avoir le temps de l’installer ! Lors du tournage de 2004, notre âne transportait un pied que nous sortions à l’arrêt pour certains plans précis. L’inconvénient est que l’on reste souvent extérieur à la scène qui se déroule, contrairement à la caméra à l’épaule, qui est plus subjective et suggestive. Là, nous étions vraiment dans les pas des pèlerins.
Le premier jour du tournage, je fus saisi par un fort sentiment d’empathie (voire de compassion) envers ces gens que Khamis Mesbah filmait avec une sorte de « sans gêne » qui me gênait considérablement à leur place. Là où j’aurais été adepte du zoom pour demeurer discret, lui n’hésitait pas à s’approcher caméra au poing très près des sujets en action. Mais alors que je redoutais intérieurement une friction, une altercation, un quiproquo, tout s’est au contraire toujours bien passé ! Les gens acceptaient paradoxalement très bien cette présence « étrangère » parmi eux : à la fois par fierté de « passer à la télévision » et parce qu’un simple regard préalable peut débloquer toutes les réticences et remplacer toute négociation intempestive. Il fallait apprendre à oser, et ce, pour la qualité du son et de l’image : plus le micro est proche, meilleur sera le son. Idem pour l’image : ainsi ai-je dû vite abandonner l’idée de zoomer de loin…
Khamis Mesbah a fait lui aussi beaucoup d’efforts pour changer certains de ses comportements. Il a dû apprendre à étendre ses « capteurs » au-delà du simple cadre de l’image et à savoir par exemple laisser la caméra tourner, ne rien tronquer, ni une parole, ni une ambiance qui aurait pu servir plus tard, ou bien parce que « la » phrase non attendue devait surgir au milieu d’un long plan séquence.
L’idéal est de déjà penser au montage dès la prise de vue, et de tendre vers ce qui serait du « tourné-monté » (sans que l’on n’y parvienne jamais). Le gain de temps est notoire. Rien ne sert de revenir avec des dizaines d’heures décousues, ou bien un même événement (qui se répète dans le temps) mal filmé à maintes reprises. Une fois bien filmé suffit. Ainsi, avons-nous essayé de nous fixer des impératifs quotidiens, que j’avais pris soin de consigner sur des feuilles de tournage, afin de cadrer notre démarche, selon ce que j’avais écrit au préalable. Mais cette écriture-là n’a absolument rien à voir avec l’écriture de fiction, ni avec de la mise en scène qui implique par exemple la direction d’acteur ! Elle correspond à la phase préparatoire au tournage, quand on réfléchit au film que l’on compte faire, sachant que tout peut changer plusieurs fois en cours de route. Car l’improvisation joue un rôle central dans notre approche documentaire, aussi bien sur le fond que sur la forme. A tout moment, il faut savoir saisir l’imprévu, la scène insolite ou la discussion inattendue qui résume tout. Cela implique d’être toujours aux aguets, d’avoir toujours la caméra à portée de main, de pressentir ce qui se trame et ce qui se dit. Il faut anticiper et oser déclencher l’enregistrement juste avant l’élément clé ; l’élan s’apparente souvent à un coup de poker et rien ne se passe, mais il suffit que ça marche une fois pour éprouver cette satisfaction grisante du plan réussi qui peut contrebalancer à lui seul l’humeur d’une journée et qui figurera intégralement dans le montage final. Sur le terrain, rien n’est écrit finalement, car tout peut arriver : de mauvaises conditions climatiques, une panne, l’absence d’un personnage déterminant, etc. Dans tous les cas, il faut s’adapter et filmer ce qui se passe, quoiqu’il arrive. Et Jean Rouch de conclure : « nos films ne s’écrivent pas, ils s’improvisent au fur et à mesure dans le viseur de la caméra… »((Langlois C., A. Morel & J. Rouch, 1986, « Le Bilan du film ethnographique : entretien avec Jean Rouch », Terrain, n° 7, pp. 77-80.)).
La question du « talent »
Le « talent » a-t-il sa place dans une approche filmique à prétention scientifique ? Car cette notion qualitative – et surtout relative – relève d’abord de la sphère dite « artistique ». Je pense qu’en matière de cinéma et d’image au sens large (en incluant la photographie), le talent signifie la maîtrise de la technique nécessaire, associée à une certaine part d’« inspiration » qui pourra donner vie à des émotions. Emotions qui sont la chair du medium cinématographique. Si l’on se pose la question du pourquoi des images esthétisantes, c’est bien parce qu’un seul plan peut résumer des pages de discours. On retrouve ici le même rapport qu’on trouve entre des écrits strictement savants et un seul vers de poésie qui peut traduire le même message, justement par la subjectivité qu’il produit chez les destinataires ou le sujet spectateur. Telle est la force de cet art : il est libre d’interprétation, il touche (à) l’irrationnel et l’émotionnel.
Nous avions donc convenu que Khamis Mesbah partirait régulièrement seul, caméra au poing et le pied sous la main, capturer de beaux plans en privilégiant la composition comme il l’entendait. Sans tomber non plus dans le cliché de la carte postale exotique, ces plans-là, où la forme prime, permirent d’équilibrer les autres pris sur le vif, en mouvement, en quête de sens parlé ou visuel (le fond). De la même manière, nous avons essayé de porter notre attention dans les temps creux, là où il ne se passe apparemment rien, sur ce qu’Arlette Farge appelle les espace-temps de « faible intensité », ou comment une scène des plus banales – un thé, un silence, un regard – et périphérique à l’action s’avère finalement propice à l’éclosion d’une émotion porteuse de sens, tout qualitatif soit-il.
Bilan du premier tournage
Malgré ses faiblesses, cette expérience de 2004 relève néanmoins de la performance, dans la mesure où c’était finalement une première : aucune équipe n’était partie à la suite des Regraga dans de telles conditions((Outre le reportage de la chaîne 2M, un premier film officiel avait été commandé par la Province d’Essaouira en 1985 et auquel s’était joint l’ethnologue Georges Lapassade pendant une dizaine de jours. Mais ce film – qui constitue certes un document – relevait bien plus d’une volonté politique que documentaire.)) : dormir dehors avec le mauvais sommeil qui en découle, marcher coûte que coûte par tous les temps, boire l’eau des puits, supporter la pluie, la chaleur, le froid ou la poussière, évoluer (en dehors des temps de marche) dans l’environnement sonore perpétuellement bruyant des moussems, accepter les mauvaises conditions d’hygiène, subir la suspicion quotidienne des habitants des nouveaux territoires parcourus et des autorités locales, et bien d’autres encore !
Ce tournage aura finalement porté de bons fruits : nos images étaient de bonne qualité. Nous avions réussi. Mais une évidence s’imposa d’elle-même : notre immersion dans la Zaouïa d’Akarmoud avait été telle que nos images manquaient de recul, voire de silence et de lenteur. Nous n’avions jamais quitté nos compagnons de peur de les perdre en chemin, alors qu’il aurait été judicieux de filmer les à-côtés du pèlerinage, d’interroger les adeptes des Regraga tout au long du chemin, notamment les femmes qui sont les principales fidèles de la Baraka des Regraga. Nous n’avions pas su décentrer notre regard. Plus largement, il manquait de quoi monter un vrai film de 52’. Ainsi se profila la nécessité de repartir lors de l’édition suivante du pèlerinage((Nous avons tout de même réalisé un sujet de 7’ En pèlerinage chez les Regraga pour l’émission Méditerranéo (France 3 Méditerranée) diffusée le 19 mars 2005.)).
La phase « production »
A notre retour en France, un nouveau producteur flaira la potentialité inédite du sujet, mais contrairement au premier producteur avec qui nous avions eu (malheureusement) à faire, celui-ci s’impliqua vraiment dans des réflexions que nous menions de concert : trouver un angle d’attaque pertinent, focaliser l’intérêt du film pour une chaîne de télévision, travailler à l’écriture du sujet pour prétendre aux subventions du Centre National de la Cinématographie. De nombreuses versions furent envisagées, notamment l’une où j’aurais été le narrateur et où je serais passé devant la caméra. Le film devait alors s’appeler La Baraka des Regraga. Tout se présentait pour le mieux en vue de l’édition 2005. Or, les accords de diffusion tant attendus des deux chaînes intéressées arrivèrent trop tard, et ce nouveau tournage tomba à l’eau. Telle est la contrainte d’un rituel indissociable du calendrier : impossible de changer les dates de tournage. Désormais, nous devions attendre l’édition 2006 : c’était reparti pour un tour !
Entre-temps, je m’installai au Maroc((Je profitai de ce séjour pour écrire un livre : Dans la peau d’un autre. Pèlerinage insolite avec les mages Regraga, Presses de la renaissance, Paris, 2007. Il s’agit de mes carnets de terrain ethnographique de 2003 transposés en témoignage vivant et personnel.)). Au printemps 2005, je partis seul avec ma caméra chez les Regraga pour continuer le tournage, en guise de dernier repérage et pour compléter mes observations. Un jour, je leur « offris » la totalité de nos rushs transposés en VHS. Je ne soupçonnais pas tous les avantages « ethnographiques » d’une telle séance de visionnage de cette quinzaine d’heures d’enregistrements. Les langues se délièrent. Si-Ahmed, qui était malade en 2004, put ainsi assister a posteriori au pèlerinage dirigé par son fils aîné Abdelhaq tout en commentant au calme ce qu’il voyait. J’en tirai donc de nombreux fruits, sans me douter encore à ce moment-là que ce serait cette formule qui serait retenue pour le montage définitif en 2007 : le père qui suit en pensée le pèlerinage de son fils.
Un film coûte cher. Surtout quand on entre dans le processus d’une coproduction où interviennent des médias nationaux. La dynamique était enclenchée, il n’était plus question de faire demi-tour. Sauf que le même scénario catastrophique se produisit en 2006 : la chaîne télévisée fit encore faux-bond et le tournage encore compromis. Aussitôt, nous sortîmes brutalement du cercle vicieux des circuits de télévision où nous étions embarqués depuis trop longtemps. Après mûre réflexion, nous décidâmes de terminer ce film coûte que coûte en 2007, avec nos propres moyens s’il le fallait. Et c’est ce qu’il advint.
Le tournage 2007
Le printemps 2007 venu, nous repartîmes seulement à deux, Khamis Mesbah et moi-même, par souci d’économie car notre budget était redevenu très limité. Sur place, pas mal de choses avaient changé. Le lien avec les Regraga s’était un peu distendu, dans la mesure où je n’habitais plus le Maroc depuis de nombreux mois. En fait, Khamis avait beau l’avoir prévenu à l’avance, Si-Ahmed manifesta une certaine frilosité à nous voir recommencer l’expérience du tournage. Il s’imaginait que nous allions gagner beaucoup d’argent avec ce film. Aussi fallut-il trouver un arrangement.
Par ailleurs, parce qu’il était désormais guéri, Si-Ahmed allait à nouveau prendre la tête du pèlerinage. Or, nous ne pouvions plus le filmer sur sa jument blanche puisque c’est son fils qui s’y trouvait trois ans plus tôt : cela n’aurait pas été « raccord » avec nos images préexistantes. Dès lors, nous devions trouver une astuce qui nous permettrait d’utiliser les images de 2004 et de 2007. La solution s’imposa : Si-Ahmed serait notre principal informateur à travers un long entretien qu’il devait nous accorder dans la cour de sa maison, au calme, quelques jours avant l’excitation du pèlerinage. Sa voix devait devenir le fil conducteur du film entier : il « commenterait » en quelque sorte le pèlerinage effectué par son fils (en 2004). Cette option plaçait la question de la transmission au cœur du film : celle de la Baraka, mais aussi celle d’un père à son fils.
Malheureusement, notre caméra tomba en panne dès le début de l’entretien, tandis que Khamis tombait, lui aussi, malade. Et parce qu’ayant investi tous nos moyens financiers, nous étions dans l’impossibilité de louer sur place une caméra professionnelle. Fallait-il rebrousser chemin ? Par chance, j’avais une petite caméra d’appoint qui nous permit de continuer, vaille que vaille, même si nos micros étaient devenus inutilisables.
Nous avons donc persisté malgré les embûches qui s’empilaient. Mais plutôt que de rester dans le sillage des pèlerins et de Si-Ahmed (que nous ne pouvions pas vraiment filmer en action à cause du « raccord » avec nos images de 2004), nous avons privilégié les entretiens avec certaines personnes ciblées, au sein et hors du pèlerinage. A d’autres moments, nous nous déplacions en voiture pour filmer avec du temps certains paysages importants, ou bien capturer des sons pour étoffer la bande sonore du film, ce que nous avions totalement délaissé en 2004. L’idée de ce tournage était de compléter le précédent dans un temps imparti et limité.
Du style
Nous étions plutôt libres, puisque ce film n’était plus destiné au réseau télévisé et que nous n’avions plus de producteur. Notre objectif : faire voir, faire connaître et partager cet univers des Regraga, du soufisme populaire marocain relativement bien préservé. Et ce, en exerçant le sens critique du public découvrant un autre visage de l’islam, du format classique du reportage télévisé où une voix-off, linéaire et continue, mâche tout le travail au téléspectateur. L’un des partis pris fut de ne pas donner forcément toutes les clés au public, d’où l’absence de ce type de commentaires extérieur et caricatural. Nous avons privilégié ce qu’on appelle « l’autocommentaire » : Si-Ahmed, le chef de la Zaouïa d’Akarmoud, « raconte » tantôt à l’écran, tantôt en voix-off, le pèlerinage qu’accomplit son fils Abdelhaq. De plus, c’était important à nos yeux que cette « parole conductrice » soit dite dans la langue des Regraga.
Par ailleurs, nous avons choisi de suggérer la richesse rituelle qu’offre un tel pèlerinage. L’image animée permet par exemple de bien rendre compte de la ferveur religieuse des adeptes des Regraga quand ils viennent solliciter la Baraka parce qu’on a l’impression d’être parmi eux. Autre exemple : regardons l’intensité éprouvée par le groupe des Sidi Bouchta Regragui, intensité inscrite jusque dans la chair de ces hommes qui s’adonnent à un dhikr (récitation rituelle et collective du nom de Dieu, accompagnée de techniques de corps et d’hyperventilation), qui se transforme progressivement en hadra (transe rituelle et collective) pendant laquelle certains se lacèrent le visage avec du verre et mâchent des cactus sans ressentir aucune douleur. L’idée n’est pas de se focaliser sur l’aspect spectaculaire de la scène, mais bien de susciter l’interrogation face à de tels rituels : jusqu’où va la ferveur religieuse ? Nous avons choisi de ne pas expliciter cette scène, à chacun de percevoir ces images selon ses propres critères, filtres et référentiels. Cette seule scène de transe mériterait un film entier si l’on avait souhaité expliciter ce qui s’y passe et faire sérieusement le tour de la question.
Finalement, notre démarche s’inscrit dans une optique de médiation scientifique, (pour ne pas dire « vulgarisation »), à l’adresse d’un public de non-spécialistes. Nous cherchons à éveiller une curiosité et certaines réflexions, sans chercher non plus à les doter de tous les bagages théoriques nécessaires à la compréhension exhaustive du pèlerinage des Regraga, ce qui serait impossible. Dès lors, chacun comprend ce qu’il peut, selon sa propre subjectivité et sa sensibilité. Tout dépendrait donc du public et des réseaux de diffusion.
De la subjectivité
La dimension esthétique permettrait-elle dès lors de « faire passer » un contenu dense et complexe – voire rébarbatif – auprès d’un public non averti ? Le langage des images est polysémique. L’image produit une émotion, un pouvoir qui nous échappe forcément et varie selon le destinataire, parce que l’image est relative. Le cinéaste est plus libre que l’ethnologue parce qu’il peut laisser libre cours à son inspiration, à son imagination, à une certaine poésie. Sa subjectivité devient son principal atout, (à condition qu’il soit impliqué dans le sujet du film, presque dans sa chair).L’ethnologue est par contre sans cesse englué dans l’éternel dilemme de la subjectivité : dans quelle mesure doit-t-on toujours prétendre à l’objectivité ? Or, ne gagne-t-on pas en objectivité à se savoir subjectif ? Je m’inscris dans la lignée d’Eliane de Latour qui considère qu’« il n’y a pas de « réel » ou de « vérité » mais une manière de faire comprendre qui elle, doit être juste. Une fois ce contrat établi, la construction reste libre. »((Morel A., 1993, « Ethnologie et cinéma : regards comparés. A propos de Contes et comptes de la cour d’Eliane de Latour », Terrain, n° 21, pp. 150-158.))
En parvenant à faire fi de nos limites respectives, nous avons chacun débordé et exploré le champ d’investigations de l’autre. Ainsi, nous avons peu à peu réussi à concilier la sensibilité cinématographique de Khamis Mesbah et mon regard anthropologique. Nous démarquant de la forme écrite des études scientifiques, notre parti pris était avant tout d’aborder cette réalité avec créativité. Ainsi avons-nous cherché à prendre quelques initiatives stylistiques, à ménager certains effets visuels dans les transitions, quoique cela reste encore assez inégal. Par exemple, nous avions eu l’idée du « portrait parlé », sorte de long plan serré du visage d’un personnage, tout en diffusant en voix-off des extraits de son entretien, si bien qu’on l’entend parler sans voir bouger ses lèvres. Nous avons donc brossé un grand nombre de tels portraits, même si deux seulement figurent dans la version actuelle (le commerçant au souk et le pêcheur dans sa barque ; les autres apparaissent dans le générique de fin en spit screen). Si le résultat d’une telle tentative n’est pas remarquable en soi, l’intention d’innover sur la forme stylistique est porteuse.
Le montage
Le montage est la phase cruciale où tout prend forme. Il s’apparente à un jeu de construction à base de milliers de briques visuelles et sonores (rushes), sauf que le stock de matériaux accumulé pendant la phase du tournage est limité. Chaque rush étant à proprement parler une séquence d’événements, on peut appliquer au processus du montage la théorie du « bricolage » chère à Claude Lévi-Strauss et à Roger Bastide. Tout peut être exploité, modelé, réutilisé, réemployé, rapiécé, et l’on jongle à loisir avec ces éléments jusqu’à trouver la meilleure combinaison, sachant que tout doit être justifiable, selon un critère de contenu ou bien de forme. Monter, c’est sculpter.
L’idéal est d’avoir une (ou des) idée(s) de montage avant même le tournage. Au cours des trois ans intermédiaires, nous avons pensé (à l’oral et à l’écrit) à de nombreux traitements possibles qui impliquaient des montages différenciés. L’un des points déterminants était la question de la temporalité du film : devait-on rester dans une chronologie linéaire pour rester fidèle au déroulement du pèlerinage ? Ou bien au contraire adopter une narration intentionnellement décousue ? Au début, j’avoue en bon ethnologue que la chronologie était capitale à mes yeux, afin de rester fidèle à la ritualité du sujet. L’inverse eût été une infidélité. Puis, à la réflexion, j’ai compris que cela pourrait enrichir le film autrement, sans en appauvrir ni en dénaturer l’ensemble. Mieux, cela pouvait l’alléger de certaines lourdeurs et répétitions. Nous avons beaucoup travaillé dans ce sens, notamment avec le second producteur et le traitement chrono-thématique s’est imposé : il permettait de concilier nos exigences, encore fallait-il pendant le tournage complémentaire de 2007 réussir à concentrer notre regard sur certains thèmes précis dans des lieux déterminés à l’avance. Par exemple, une séquence consacrée à la distribution rituelle des offrandes de couscous aux Regraga devait être filmée dans une unité de lieu et de temps. Et nous ne pouvions plus au montage piocher dans des extraits filmés en plusieurs lieux différents (puisque le rituel, étant quotidien, se répète). Cette approche nous forçait à rester un minimum fidèle à la question du raccord et de la fluidité, prépondérante pour le cinéaste, beaucoup moins pour l’ethnologue. Nous avions décidé de ne pas nous embarrasser avec ce type de contraintes formelles (vêtements, positionnements) mais d’en tenir compte dans la mesure du possible. Ce choix nous a forcés à préparer méticuleusement le planning de tournage de chaque jour.
Le rythme du film oscille donc entre deux temporalités : celle du père et celle du pèlerinage. Notre parti pris a été de prendre le temps d’installer les personnages et le sujet au-delà des quinze premières minutes. Par-là, nous prenions à contre-pied les canons télégéniques actuels. Une responsable des documentaires d’une chaîne nationale qui visionna le film m’avoua que le début n’était pas assez « pulsé ». En effet, le téléspectateur qui n’est pas « accroché » dans la première minute ira voir ailleurs. Telle est la réalité de notre société de l’image où le « zapping » est généralisé. En fait, tout dépend de la finalité du film, quel qu’il soit. Un reportage télévisé doit être rythmé, accrocheur, (voire racoleur), pour répondre à des impératifs d’audience. Il est par contre préférable de voir tout documentaire, film d’auteur ou film ethnographique, dont le rythme n’est pas formaté, dans une salle de projection où l’on reste du début à la fin.
La version actuelle du film Les Chemins de la Baraka a été spécialement montée pour le Festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo en mai 2007. D’une version initiale et provisoire de 26’, nous sommes arrivés à un documentaire de 50’. Seulement, nous l’avons élaboré de nos propres mains, sans le concours extérieur d’un monteur qui aurait apporté le recul que cela suppose. Sans doute est-ce la carence majeure du film. Mais rien n’est définitif, et nous envisageons d’ores et déjà de travailler à une seconde version du film.
Les Chemins de la Baraka est-il un film ethnographique ? Dit-il autrement ce que ce qu’une étude scientifique pourrait apporter ? Nous n’avons jamais eu cette prétention. Au fond, ce film provient d’une ethnographie qui s’est avérée fondatrice. La force inégalée de l’image est de faire pénétrer directement son public, « comme par magie », à l’intérieur d’une réalité sociale et culturelle différente, et ce, sans l’effort laborieux qu’exige la lecture. Mais à quoi cela sert-il de classer, étiqueter, labelliser ou non tel ou tel film ? Laissons à Jean Rouch le soin de répondre par cette pirouette : « Il est également important de ne pas enfermer les films dans des catégories : film ethnographique, film sociologique, film géographique : tous ces films sont des films. Je dis toujours, en plaisantant, que pour les cinéastes je suis ethnographe et pour les ethnographes je suis cinéaste : ainsi je ne suis nulle part, ce qui est bien commode »((Langlois C., A. Morel & J. Rouch, 1986, « Le Bilan du film ethnographique : entretien avec Jean Rouch », Terrain, n° 7, pp. 77-80.)).
Il s’agit avant tout d’une expérience d’un témoignage filmique sur un phénomène rituel : le Daour des Regraga. A cet égard, le film devient dès lors un « document ethnographique » daté sur une réalité donnée. Grâce à ce « troisième œil » qu’est la caméra, ce formidable appareil de capture d’informations sur le terrain – (le fameux « bloc-notes » cher à Marcel Griaule) – l’ethnologue (et l’historien de demain) peut constituer de précieuses banques de données. Cet archivage détient un intérêt muséographique évident au sens de la conservation, mais aussi au sens d’exposition au grand public. Effectivement, le film permet aux visiteurs non-spécialistes de visualiser par exemple le maniement d’un objet précis dans son contexte originel, ce qui faisait dire à Jean Rouch : « Et c’est, à mon sens, ce que devrait être le nouveau musée de l’Homme, non plus les vitrines glacées des sciences humaines, mais des fenêtres ouvertes sur un monde non pas figé mais animé par la magie du cinéma »((Ibid.)). Encore faut-il que cette mise en images soit abordable, « agréable à l’œil » et non pas rébarbative.
La dimension esthétique des images, à travers les émotions et les effets qu’elles suscitent, transmet des messages et des informations déterminantes au public. Sans doute faut-il viser un certain équilibre entre le fond et la forme. L’un au service de l’autre, et vice versa, ou quand éthique et esthétique font bon ménage. Parce que la déontologie de l’ethnologue est néanmoins cruciale : sans elle, il serait très facile de manipuler les images et de les faire mentir.
J’ai commencé mon apprentissage audiovisuel avec ce film, mais la route est encore longue. Sans doute que le terrain demeure la meilleure école : on essaie, on se trompe, on recommence, on tâtonne et on avance à force de persévérance. Aujourd’hui, même accouché dans la douleur, ce film existe, et c’est une première pierre.
Khamis Mesbah et moi-même assumons une certaine liberté d’expression, sur le fond comme sur la forme. Pourtant, on n’est jamais vraiment libre, car faire un film est un compromis perpétuel : avec l’équipe, les informateurs, les personnages, les conditions météorologiques, les autorités, les producteurs, etc. Aussi faut-il se résoudre à l’idée que l’on ne peut pas tout filmer, ni tout montrer, ni tout expliciter. Nous avons appris à choisir, et c’est déjà beaucoup : car filmer, c’est choisir.
Bibliographie
De France C., 1982, Cinéma et Anthropologie, Paris, éd. de la MSH
— 1994, Du film ethnographique à l’anthropologie filmique, Bâle, Bruxelles, Paris, Ed. des archives contemporaines
Langlois, C., Morel A., & Rouch J., 1986, « Le Bilan du film ethnographique : entretien avec Jean Rouch », in Terrain, n° 7
Langlois C., Morel A., & Piault C., 1986, « Cinéma et ethnologie européenne : entretien avec Colette Piault », Terrain, n° 6,
Morel A., 1993, « Ethnologie et cinéma : regards comparés. A propos de Contes et comptes de la cour d’Eliane de Latour », in Terrain, n° 21
Pénicaud M., 2005, « Le Daour des Regraga. Un Rite de Régénérescence », in Les Pèlerinages au Maghreb et au Moyen-Orient. Espaces publics, espaces du public, ouvrage collectif, IFPO, Beyrouth
— 2007, Dans la peau d’un autre. Pèlerinage insolite avec les mages Regraga, Presses de la renaissance, Paris
Rouch J., 1968, Le film ethnographique, in Ethnologie générale, (vol. publié sous la direction de J. Poirier) Encyclopédie de la Pléiade, Paris, Gallimard.

Manoël Pénicaud
- Manoël Pénicaud
- Manoël Pénicaud

